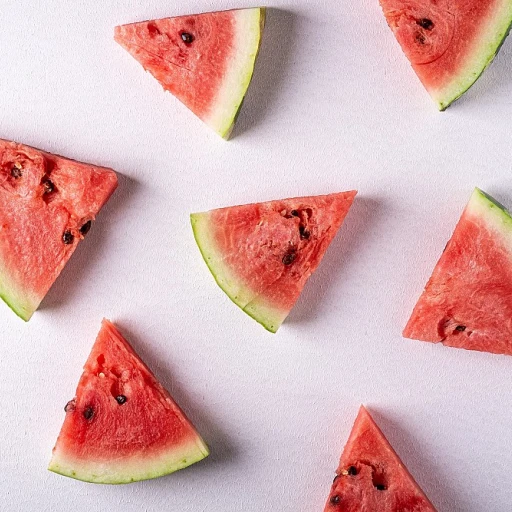Bonjour Sophie, pourriez-vous nous parler de ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans la gestion des risques juridiques et la prévention des litiges?
Initialement, ma pratique était exclusivement consacrée au contentieux des affaires et au droit pénal des affaires. Défendre les entreprises dans le cadre de leur contentieux et précontentieux, ainsi que dans le cadre de procédures pénales, m’a permis, au fil des années, d’identifier les principaux risques juridiques auxquelles elles sont confrontées et de comprendre leurs enjeux commerciaux, financiers, organisationnels et réputationnels.
C’est donc tout naturellement que j’ai décidé de me spécialiser dans la prévention des risques et des litiges, en complément de ma pratique d’avocate en contentieux. Ces domaines sont, à mon sens, parfaitement complémentaires. L’accompagnement des entreprises en matière de conformité m’a en effet réciproquement permis de développer une vision pragmatique et business de la stratégie à mettre en œuvre sur le plan contentieux.
Le cabinet Apostrophe, que j’ai cofondé avec mon associée Delphine Dendievel, est dédié à cette double expertise : le contentieux et le droit pénal des affaires, d’une part, la conformité et les enquêtes internes, d’autre part.
En tant qu'avocat associée, comment conseillez-vous les directeurs juridiques dans l'identification proactive des risques émergents susceptibles d'entraîner des litiges?
L’identification des risques est la pierre angulaire de la conformité.
Au-delà évidemment de la veille juridique et sectorielle à mettre en place, l’identification des risques repose avant tout sur une compréhension très approfondie et très opérationnelle des activités de l’entreprise. Je le constate, par exemple, en matière de programmes de conformité anti-corruption. Lorsque j’aide mes clients à déployer l’outil de prévention majeur que constitue la cartographie des risques de corruption, j’insiste sur la nécessité de réaliser au préalable un inventaire détaillé des entités, des activités, des pôles et des processus mis en œuvre au sein du groupe. Ce travail préparatoire indispensable permet de mettre en lumière les processus les plus à risque et, pour chacun de ces processus, les scénarios de corruption qui leur sont spécifiques. Bien mené, cet exercice de cartographie des risques permet de mettre en place des dispositifs de prévention efficaces en instaurant des procédures, des mesures de contrôles (de 1er, de 2ème ou de 3ème niveau) et des actions de formation, réellement adaptés et proportionnés.
Un autre outil majeur de détection qui peut, ou qui doit (dans certains cas), être déployé au sein de l’entreprise est le dispositif d’alerte éthique. Les alertes, lorsqu’elles sont recevables, mènent à des enquêtes internes (c’est-à-dire à des investigations menées en interne par l’entreprise pour faire la lumière sur les faits allégués par le lanceur d’alerte) dans des domaines divers (fraude, corruption, harcèlement moral, violation de prescriptions réglementaires ou d’obligations de sécurité, devoir de vigilance, etc.). Les directions juridiques ou les directions des ressources humaines peuvent conduire ces enquêtes elles-mêmes ou les externaliser. Dans certaines hypothèses, et notamment pour certains sujets particulièrement sensibles ou complexes, l’externalisation de l’enquête interne est pertinente car elle permet de bénéficier d’une méthodologie d’enquête robuste et conforme à la réglementation et à la jurisprudence, d’un positionnement indépendant et impartial de l’enquêteur et, lorsque l’enquête est confiée à un cabinet d’avocats, du secret professionnel.
Pourriez-vous partager un exemple où une approche innovante dans la prévention des litiges a permis à l'un de vos clients d'éviter un contentieux majeur?
Les directions juridiques mettent quotidiennement en place des outils de prévention des litiges, notamment contractuels. Elles le font au travers de modèles de contrats, d’outils de suivi et d’audit contractuel, de veilles réglementaires, ainsi qu’en donnant au quotidien des avis juridiques aux opérationnels et en les accompagnant dans la contractualisation de leurs relations les plus délicates et stratégiques.
Toutefois, la prévention des litiges ne s’arrête pas là où commence le contentieux, ni même le précontentieux. Les directions juridiques ont un rôle essentiel à jouer aux prémices de la naissance d’un différend. Souvent, c’est très en amont que des situations se tendent inutilement, que des malentendus se cristallisent et que des erreurs sont commises par des équipes parfois trop impliquées dans le projet. L’avis extérieur et expérimenté du directeur juridique et son accompagnement peuvent être décisifs pour éviter la naissance d’un litige, en précisant aux parties prenantes le cadre juridique applicable et en ouvrant la voie de la négociation.
J’ai pu constater l’efficacité de cette approche à plusieurs reprises. Cela n’a rien d’innovant mais, en pratique, je constate qu’il est souvent difficile d’inciter les opérationnels à solliciter la direction juridique de manière anticipée. Pour y parvenir, il faut inculquer une culture d’entreprise axée sur la prévention des litiges et ouvrir des canaux de communication fluides avec la direction juridique.
Dans votre expérience, quels sont les défis majeurs que rencontrent les grandes entreprises versus les PME en matière de gestion des risques juridiques?
Pour les grandes entreprises, la gestion des risques est d’autant plus ardue qu’elles sont sous les feux des projecteurs, scrutées par les régulateurs et les juridictions qui attendent d’elles une conduite irréprochable et exemplaire, mais aussi par les ONG, les associations de défense, la presse et, plus largement, l’opinion publique. Elles doivent se prémunir contre des risques nombreux et divers, dans un environnement normatif souvent pluriel, notamment lorsqu’elles opèrent dans plusieurs zones géographiques.
Pour les PME, la difficulté tient souvent aux ressources limitées des directions juridiques ou conformité, lorsqu’elles existent, ou même à l’absence de toute ressource dédiée à la gestion des risques. Lorsqu’une PME est en période de forte croissance, toutes les forces vives sont mobilisées sur les objectifs de développement. Des risques juridiques majeurs peuvent alors ne pas être détectés ou traités correctement. Le recours à des conseils externes pendant ces phases de fort développement peut alors être opportun, si ces conseils connaissent bien l’activité de l’entreprise et s’ils proposent un accompagnement adapté et proportionné à la taille de l’entreprise et aux enjeux qu’elle rencontre.
Comment les évolutions récentes du droit influencent-elles la stratégie de prévention des litiges pour vos clients, et avez-vous observé des tendances particulières ces dernières années?
La prévention des litiges ne se limite plus aux litiges commerciaux. Les risques juridiques les plus importants pour les entreprises se situent désormais sur le terrain réglementaire avec l’émergence continue de nouvelles réglementations et leur durcissement (anti-corruption, données personnelles, RSE, intelligence artificielle, sécurité informatique, etc.) et l’émergence d’une forme d’activisme judiciaire (actions des ONG et des associations, actions de groupe, etc.). Le risque de poursuites et de sanctions des régulateurs (Agence Française Anti-Corruption, CNIL, DGCCRF/DDPP, Autorité de la concurrence, AMF, ACPR, etc.) et le risque de poursuites pénales, ainsi que le risque réputationnel qui en découle, sont désormais au cœur des préoccupations des directeurs juridiques et de la conformité.
De surcroît, certaines de ces réglementations demeurent particulièrement mouvantes, telles que celle sur le devoir de vigilance introduite par la loi du 27 mars 2017. Ce cadre législatif vient tout juste d’être précisé par l’arrêt La Poste de la chambre 5-12 des « contentieux émergents » de la Cour d’appel de Paris du 17 juin 2025. Parallèlement, au niveau européen, la directive européenne CSDDD, bien qu'adoptée le 24 avril 2024, a vu son calendrier de transposition repoussé par la directive "Stop the Clock" adoptée le 16 avril 2025.
Quel conseil donneriez-vous aux directeurs juridiques pour bâtir une culture d'entreprise axée sur la conformité et la gestion des risques?
L’implication de la direction générale est essentielle pour que la conformité occupe une place centrale dans la politique de l’entreprise. Cette implication doit s’illustrer par des actions très concrètes, d’abord, sur le plan organisationnel, notamment par le positionnement hiérarchique du directeur de la conformité ou du directeur juridique, par les moyens humains et financiers mis à sa disposition, par l’évocation régulière des sujets de conformité au sein des différentes instances de direction (Comex, Codir, etc.) et la constitution d’un comité conformité au sein du conseil d’administration. Cette implication doit également s’illustrer par des communications internes et externes régulières sur les sujets de conformité.
En parallèle, et outre la formation régulière des équipes qui est bien sûr essentielle, il faut veiller à ce que les procédures internes, souvent élaborées par des juristes, puissent être effectivement et efficacement mises en œuvre. Cela nécessite de concevoir des process simples et compréhensibles pour les équipes censées les appliquer, adaptés à leurs activités et à leur organisation et cohérents avec les autres process déjà en place au sein de l’entreprise.
Enfin, la mise en place d’un dispositif d’alerte éthique, et le traitement de ces alertes par la conduite d’enquêtes internes, est souvent une étape décisive dans la construction d’une culture de conformité. Les alertes et les enquêtes internes ne sont pas seulement des outils de détection des risques. Elles ont une vertu pédagogique, en instaurant une relation de confiance (puisque l’alerte est traitée) et en ouvrant un dialogue (notamment, grâce à la conduite d’entretiens avec les salariés concernés lors de l’enquête interne).
À votre avis, comment la digitalisation et la technologie transforment-elles actuellement le paysage de la prévention des litiges, et quelles opportunités offrent-elles aux directeurs juridiques?
La digitalisation et la technologie sont évidemment des atouts pour la prévention des litiges, par exemple, grâce à l’automatisation du suivi et de l’audit contractuel ou à celle de la veille juridique avec l’IA. Toutefois, la prévention des litiges ne peut pas reposer entièrement sur ces outils.
A titre d’exemple, des logiciels performants sont proposés aux entreprises pour les aider à évaluer un très grand nombre de « tiers » (fournisseurs, prestataires, clients, bénéficiaires de dons, partenaires, etc.), en automatisant et en sécurisant le processus d’évaluation. Toutefois, ces outils permettent un premier niveau d’évaluation mais les situations à risque doivent toujours être soumises à l’œil expert du directeur juridique ou du directeur de la conformité qui a la compétence, l’expérience et la connaissance de l’entreprise, lui permettant d’évaluer précisément le risque afférent au tiers concerné.
Pour en savoir plus : apostrophe-avocats.com